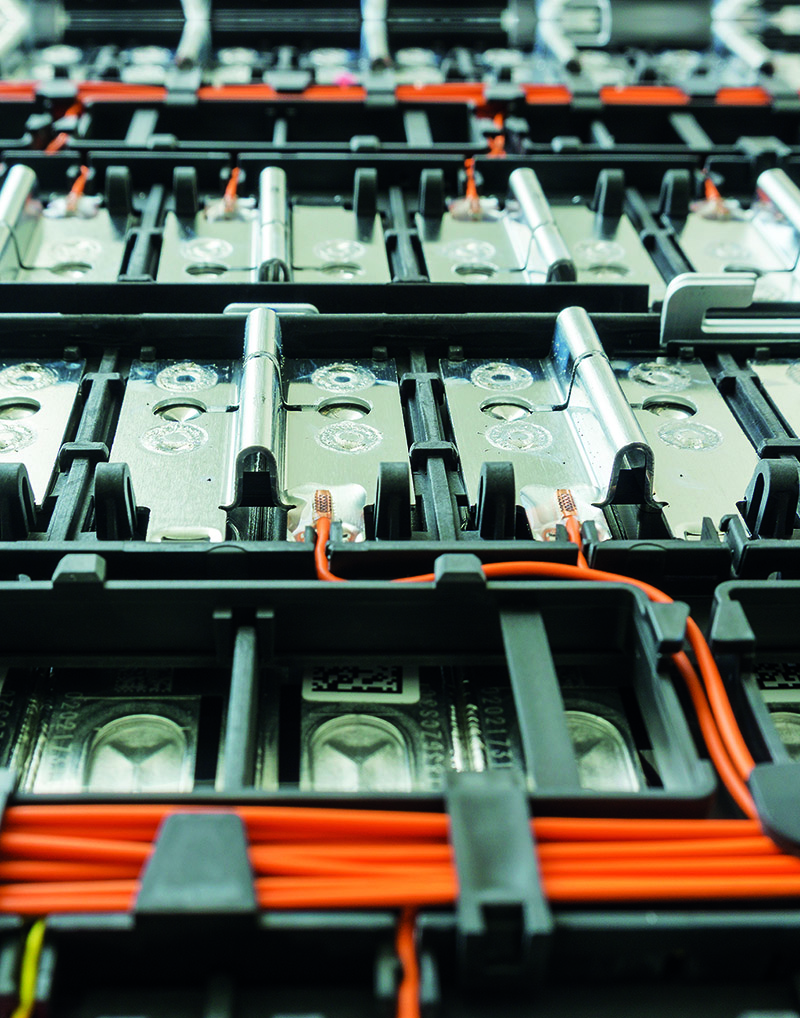Les cancers professionnels en Europe
Eurogip a publié en décembre 2018 un rapport intitulé « Sinistralité et repérage des cancers professionnels dans neuf pays européens » qui fait le point sur l’évolution de la reconnaissance des cancers professionnels et leurs dispositifs de repérage.

Un cancer est professionnel lorsqu’il est la conséquence de l’exposition d’un travailleur à un facteur cancérogène sur son lieu de travail. Il peut être d’origine chimique (métaux lourds, amiante, huiles minérales, poussières de bois, silice cristalline, benzène, goudron…), physique (rayonnements radiologique, UV, champs électromagnétiques) ou biologique (certains virus sont facteurs de risque).
Eurogip, groupement d’intérêt public qui œuvre pour la prévention et l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles en Europe, a publié en décembre 2018 un rapport sur la sinistralité et le repérage des cancers professionnels dans les neuf pays européens suivants : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Italie, la Suède et la Suisse.
Les secteurs professionnels impactés
Les secteurs d’activité les plus concernés par les expositions à un facteur cancérogène sont la construction, la métallurgie, les industries chimiques, du cuir et du caoutchouc, du bois, l’industrie pétrolière et l’agriculture.
Il est souvent difficile d’établir le lien entre le cancer et une exposition professionnelle. D’autant que le temps entre l’exposition et l’apparition de symptômes est de 20 ans en moyenne, peut même atteindre 40 ans… Et que les travailleurs ne connaissent pas toujours les substances cancérogènes auxquelles ils ont été exposés.
L’amiante, cause numéro 1 des cancers professionnels
Dans tous les pays, à l’exception de l’Allemagne, les cancers dus aux poussières d’amiante constituent l’écrasante majorité des cancers professionnels reconnus en 2016. Les mésothéliomes représentent plus de 30% des cancers professionnels au Danemark. 50% en Autriche et en Italie. 65% en Belgique. Et près de 90% en Suède.
Mieux repérer les cas de cancers professionnels
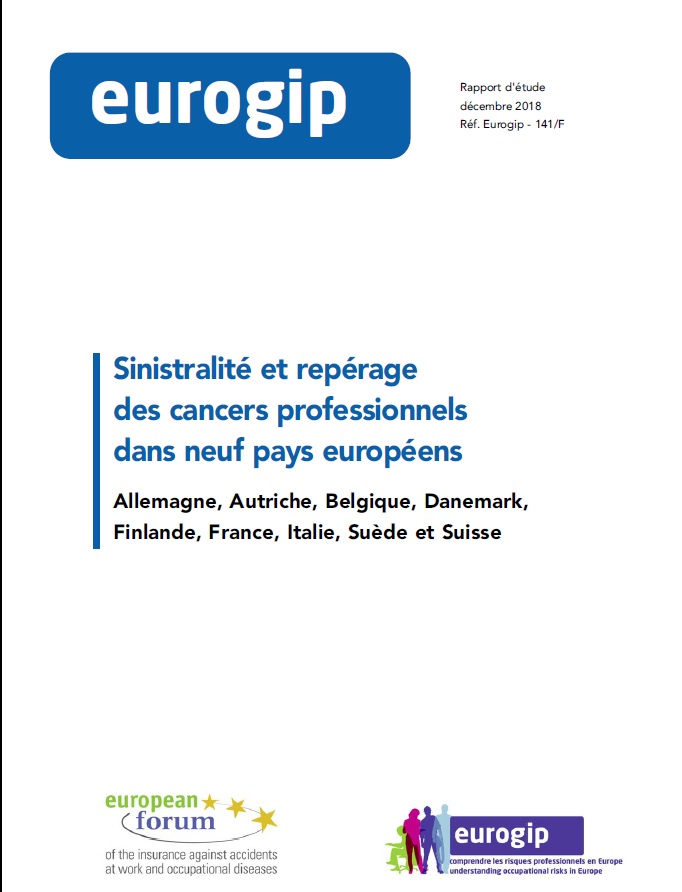
Des scientifiques ont estimé que 4 à 8,5 % des cancers auraient une origine professionnelle. Or, quel que soit le nombre de cancers d’origine professionnelle reconnus et indemnisés, tous les pays s’accordent pour dire qu’ils sont sous-déclarés.
Conscients de cette problématique, plusieurs d’entre eux ont mis en place des dispositifs permettant d’améliorer le repérage. Deux types d’initiatives ont pu être identifiées :
- permettre aux travailleurs (ou ex-travailleurs) exposés dans le passé à des agents cancérogènes d’accéder à une surveillance régulière de leur santé ;
- cibler les travailleurs (et ex-travailleurs) atteints d’un cancer qui pourrait résulter d’une exposition professionnelle.
Le dispositif de la France pour le cancer de la vessie
Depuis 2008, la France expérimente un programme de repérage de l’origine professionnelle possible des tumeurs de la vessie. Il s’agit de repérer, parmi les malades atteints d’un tel cancer, ceux qui ont été exposés durant leur vie professionnelle à des agents nocifs et de les sensibiliser à la procédure de déclaration en maladie professionnelle aux fins de reconnaissance.
Depuis cette expérimentation, sur l’ensemble du territoire français, le nombre de cas reconnus entre 2007 et 2016 a été multiplié par 7,5.
La prévention et la protection des travailleurs
La recherche de victimes de cancers professionnels est une chose. La prévention de ces pathologies en est une autre. Au plan européen, les cancers causés par le travail sont l’un des principaux chantiers législatifs en matière sociale. À ce sujet, la révision lancée en 2016 de la directive européenne de 2004 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail comporte quatre priorités :
- l’inclusion des substances toxiques pour la reproduction ;
- l’adoption de nouvelles valeurs limites d’exposition professionnelle (Vlep) ;
- la révision des Vlep existantes ;
- l’adoption de critères permettant de définir des Vlep.
Cette révision a déjà abouti à l’adoption de la directive 2017/2398 qui doit être transposée avant le 17 janvier 2020. Elle impose d’une part aux États membres d’organiser une surveillance de la santé des travailleurs au-delà de la période d’exposition. Et adopte d’autre part des Vlep pour 11 nouvelles substances et révise celles des poussières de bois durs et du chlorure de vinyle monomère.

Martine Porez – Journaliste
Les plus lus…
Les particules solides présentes dans les environnements industriels et de fabrication présentent des risques significatifs pour les employés et…
Un arrêté du 1er avril 2025 modifie les articles CH3 et suivants du règlement de sécurité contre les risques d'incendie…
Un spectaculaire incendie a ravagé, dans la soirée du 7 avril 2025, un centre de traitement de déchets dans le…
Danger pour les personnes et les biens, charges supplémentaires sur les finances du bloc communal, insécurité juridique croissante des…
Un incendie de batteries lithium a touché l'entreprise SUN'R, site soumis à déclaration, le 3 juin 2022. Le Bureau…
Trois règlements d’exécution pris par la Commission européenne dans le cadre du règlement 2024/573 du Parlement européen et du conseil…