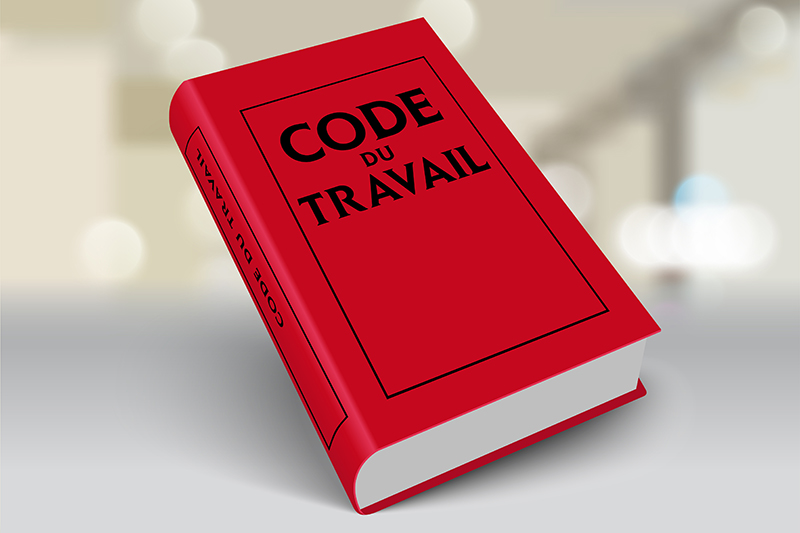Administrations et collectivités territoriales / BUP / ERP/IGH / Industrie/ICPE / Sécurité civile et forces de l'ordre / Sécurité privée / Sûreté
Comprendre le terrorisme en entreprise
Journaliste et écrivain, auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale, Nicolas Hénin propose, dans son livre Comprendre le terrorisme – Bâtissons une société résiliente (Fayard), les clés de compréhension du terrorisme. Entretien sur la menace du terrorisme en entreprise.

Face aux traditionnels « marchands de peur », l’analyse de Nicolas Hénin est avant tout pédagogique. Le sujet ne lui est pas étranger. Le 22 juin 2013, il a été enlevé à Raqqa (Syrie) et est resté otage jusqu’au 18 avril 2014.
Récemment, avec quatre autres professionnels dont Mourad Benchellali, ancien prisonnier de Guantanamo, il a fondé la société « Action résilience » et un think tank éponyme. L’objectif est de fournir des conseils en dialogue social et de la formation pour prévenir et gérer les conflits liés à la radicalisation en entreprise. Il nous explique les enjeux.
Face au Risque. « Terrorisme » est un mot difficile à définir…

Nicolas Hénin. L’un des grands problèmes avec le terrorisme, c’est qu’il faut éviter les trois écueils, qui constituent une sorte de triangle : le déni, la sidération et la panique. Face à cela, il est difficile de raisonner de manière sereine.
Pourtant il faut garder en tête que l’attaque terroriste ne cherche pas tant les dégâts cinétiques – qui restent souvent très faibles à quelques exceptions près – que l’impact psychologique.
Le terrorisme est un concept qui se laisse mal définir et sur lequel aussi bien les juristes que les politologues s’écharpent régulièrement. Les frontières sont mal dessinées et parfois idéologiques.
À quel moment l’insurgé irakien qui se bat contre l’occupation n’est plus un résistant, reconnu par le droit international, et devient-il terroriste ?
Il faut garder en vue quatre critères qui sont les conditions nécessaires du terrorisme : une violence, même symbolique, commise par une entité non étatique, contre des civils et avec des objectifs politiques. Il ne faut pas se tromper.
Nelson Mandela a été considéré comme terroriste par les États-Unis jusqu’en 2008 alors même qu’il avait reçu le Prix Nobel de la paix 15 ans plus tôt. C’est pourtant une icône des droits civiques.
La définition est fondamentale : si je discute avec un jeune radicalisé et qu’on arrive à s’entendre sur une définition du terrorisme, alors d’une certaine façon une bonne partie du travail de « déradicalisation » est fait.
Cela permet de poser des limites, notamment sur l’usage de la violence légitime. Il y a des causes justes, y compris pour des rébellions armées, mais il ne faut pas que les civils soient pris à partie. La violence contre eux est toujours injustifiable.
Dans votre livre, le mot « radicalisation » est un peu mis à distance, de quoi s’agit-il ?
N. H. C’est un terme qui s’est répandu parce qu’il souffre d’un grand flou dans sa définition. L’une des définitions qu’on peut donner au radicalisé c’est une personne qui refuse de vivre en égalité dans une société pluraliste.
Quiconque se positionne dans ce refus est radicalisé. Certaines idéologies mettent en avant l’égalité. D’autres mettent en avant le pluralisme mais oublient le côté égalitaire. Au final, quand on s’éloigne de ces valeurs, on rentre dans l’extrémisme.
Dans l’entreprise, le responsable de la sécurité doit s’assurer de la sécurité du personnel et du public. Son travail est aussi de détecter les signes de radicalité. Quels signaux retenir ? Le refus par un homme de serrer la main aux femmes, par exemple ?
N. H. Les mêmes signaux peuvent être interprétés différemment. La priorité est de différencier les problèmes qui sont du domaine des comportements de ceux qui sont du ressort de la sécurité. Parce que la réponse sera extrêmement différente.
D’un côté, on a des comportements contraires à nos valeurs ou à celles de l’entreprise. Ils peuvent poser des problèmes d’ambiance, de relations entre salariés ou avec la clientèle. Ce peut être des problèmes d’image. Ils sont sérieux et il faut les traiter à un niveau RH ou avec l’encadrement.
De l’autre côté, il peut y avoir des problèmes de sécurité et avec potentiellement des personnes qui peuvent passer à l’acte de manière violente. Ils doivent être traités par la direction de la sûreté de l’entreprise avec une interaction avec les Pouvoirs publics.
Pour caricaturer cette segmentation, on n’ira pas envoyer une assistance sociale à un forcené, mais pas non plus la police à un individu en simple rupture sociale… Il faut ségréguer les situations de radicalisation non-violente ou ne présentant pas de risques de sécurité et les situations beaucoup plus rares présentant des enjeux de sécurité.
Par ailleurs, celui qui présentera des problèmes de sécurité s’arrangera pour être indétectable. Ce n’est typiquement pas celui qui refuse de serrer la main d’une femme qui fera un attentat. Le vrai terroriste est dans une démarche de dissimulation comme tout acteur clandestin qui cherche à protéger son plan.
L’évaluation est capitale. Si on se trompe de maladie, on se trompe de traitement. Dans le meilleur des cas, on va faire perdre du temps aux services de police qui interviendront sur un marginal, mais potentiellement on peut aussi le radicaliser encore plus.
Certains responsables sécurité aimeraient bien avoir des informations justement sur ceux qui pourraient être fichés « S » dans leur entreprise, pensez-vous que c’est une bonne idée ?
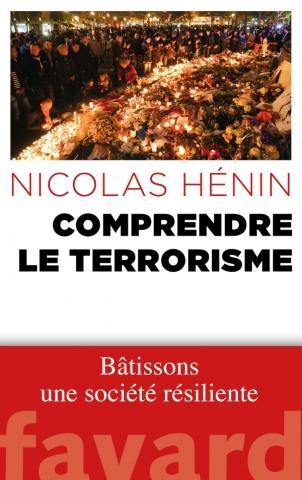
N. H. Le travail des services de police et de renseignement est un monopole souverain qu’il faut respecter. C’est au service de sécurité des entreprises de leur fournir des informations et non pas l’inverse. Cela dit, il est évident que l’échange fluide de certaines informations dans les deux sens est un bénéfice mutuel.
Dans les entreprises sensibles, on peut mettre en place des procédures de gestion de la radicalisation comme repérer les signaux faibles. C’est ce que nous avons fait par exemple avec un office HLM pour ses locataires. Il faut avoir des relations de confiance avec un référent de l’État.
Bien souvent, face à un salarié radicalisé, l’employeur préférera un licenciement. Ce n’est pas forcément la solution, ni en termes de risques, ni en termes d’image.
Comment agissez-vous sur ces phénomènes ?
N. H. Lorsque nous sommes alertés par une entreprise qui signale un salarié radicalisé, notre stratégie est d’intervenir auprès de lui et de son environnement professionnel pour essayer de réduire la fracture.
Ça ne marche évidemment pas dans tous les cas. Lorsqu’une personne est en situation de rupture et qu’en plus on lui fait perdre son travail, le risque sera peut-être éloigné de l’entreprise mais le problème sera déplacé sur le reste du corps social. Et encore, le salarié pourrait très bien revenir se venger dans son ancienne entreprise comme cela a pu être parfois observé !
Nous considérons que le licenciement ne peut pas être écarté par principe, certaines situations sont sans issue – mais le licenciement doit être la dernière extrémité et représente à nos yeux un échec. D’où la médiation que nous initions avec notamment Mourad Benchellali.
C’est un travailleur social qui a un excellent contact avec les personnes en situation de radicalisation, parce qu’il est passé par là et qu’il en est revenu.
Existe-t-il un risque pour les entreprises ?
N. H. Le risque existe. Il ne faut pas le surévaluer ou le négliger. Il faut faire une analyse sereine de sa réalité en tenant compte des spécificités de l’entreprise. Mais il n’y a pas de recette miracle qui s’appliquerait à tous. Il faut construire une analyse fine en étroite relation avec les ressources humaines et la direction de la sûreté.
Il y a eu des vrais problèmes. Dans certaines entreprises, on a laissé proliférer des foyers de radicalisation. Il y a eu, dans certaines, des vagues de dizaines de départs en Syrie.
Dans des entreprises publiques, des opérateurs de transport, des constructeurs automobiles… Il y a eu beaucoup de rumeurs également. Il ne s’agit pas que d’un risque d’image. Les risques de sabotage dans l’industrie ou d’attaque vis-à-vis du public dans le tertiaire existent.
Le drame de Saint-Quentin-Fallavier a été un vrai traumatisme pour les industriels. Les entreprises ont raison d’être inquiètes mais il faut garder la tête froide. Surévaluer le risque que fait peser sur nous l’ennemi, c’est déjà un peu lui concéder une victoire.
Quelles peuvent être les cibles ?
N. H. La propagande djihadiste est très loquace. On a une diffusion très large, en ligne, avec la préconisation de modes opératoires et la désignation de cibles. L’un des objectifs est de saturer les capteurs et les capacités d’analyse, mais aussi de mettre un maximum de personnes en capacité de commettre un attentat.
Quand on regarde les cibles particulièrement désignées, il y a tous les lieux accueillant du public de manière dense, en particulier lorsqu’ils sont associés à une occasion festive.
Le choc émotionnel sera amplifié. En vrac, on peut citer un feu d’artifice municipal comme le 14 juillet à Nice, des grands magasins pendant la période de Noël, les infrastructures de transport qui sont historiquement une cible, qu’il s’agisse de l‘aérien ou du ferroviaire.
L’idée est toujours de viser des lieux dans lesquels il y a une forte concentration de personnes avec des difficultés d’échappement(s) ou d’évacuation pour les victimes comme les cinémas, les boîtes de nuit…
Il faut également surveiller les techniques qui sont utilisées sur les grands terrains de guerre pour lesquels il y a eu une diffusion des savoir-faire, en particulier en Syrie et en Irak.
Parmi ces menaces, l’attentat à la voiture piégée – qui n’a pratiquement jamais été utilisé en France –, le sur-attentat, l’usage du drone, qui s’est énormément développé ces deux dernières années sur le terrain, tout comme celui – qui demanderait d’énormes capacités logistiques – des missiles filoguidés.

David Kapp – Journaliste
Les plus lus…
Les sciences du danger sont également appelées "cindyniques". Elles cherchent à identifier toutes les sources de risque pour mettre…
SHOWA, leader mondial de la protection des mains et des bras, exposera à Preventica Paris du 10 au 12…
International SOS, spécialiste mondial des services de gestion des risques de santé et de sécurité, a publié un nouveau rapport…
Le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 écarte de la liste des salariés bénéficiant du suivi individuel renforcé (SIR)…
Milestone Systems a officialisé son nouveau partenariat avec la start-up française Wintics le mardi 1er avril 2025. Thomas Jensen, PDG…
Le règlement européen révisé sur les produits de construction (EU CPR 2024/3110) est officiellement entré en vigueur le 7 janvier…